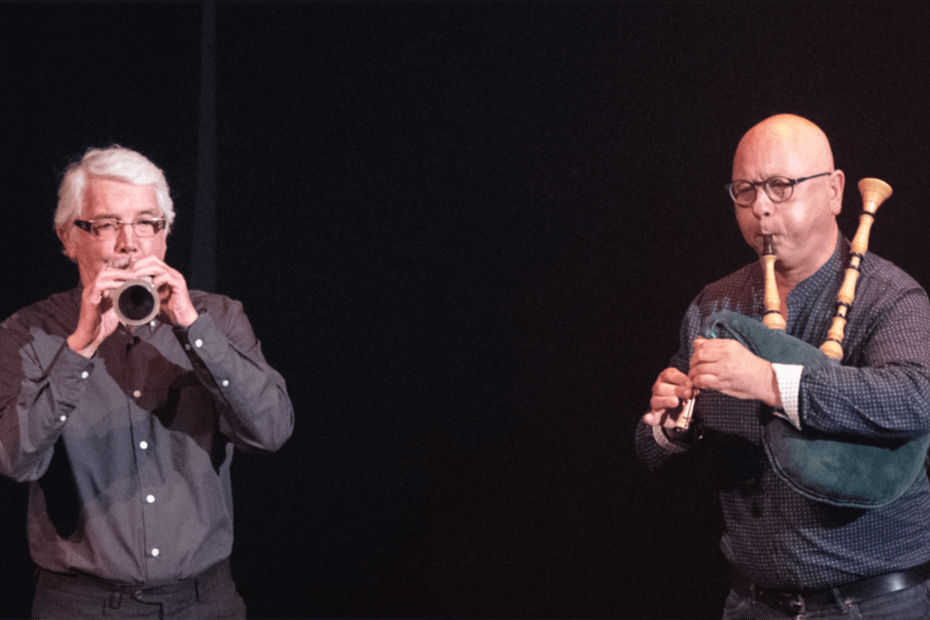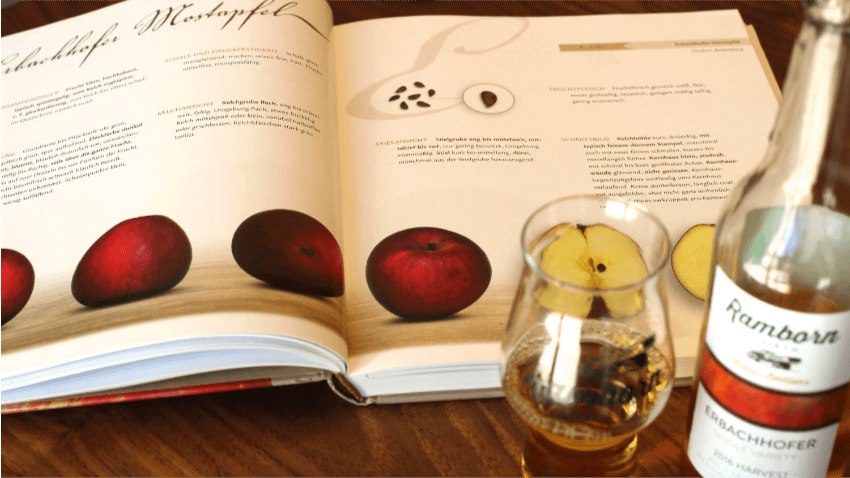L’homme le plus médaillé du canton
Les cloches de l’église avaient sonné mâtines et les pigeons, bons connaisseurs des pratiques locales, se massaient en nombre dans le vénérable clocher dont les rondeurs romanes trahissaient l’ancienneté. En… Lire la suite »L’homme le plus médaillé du canton